À l’origine du mouvement trans : des hommes qui jouissent (sexuellement) de l’oppression des femmes
Retour sur une réalité taboue et pourtant centrale du mouvement trans
Dans l’optique de faire retrouver la raison à la gauche concernant le phénomène transidentitaire, je vous propose une brève exploration de ses origines.
Il est impossible de comprendre le phénomène trans sans connaître un minimum l’histoire du travestissement masculin – c’est-à-dire des hommes qui se travestissent en femmes, ou, plutôt, en l’image qu’ils en ont. Pourquoi ? Parce qu’historiquement, le phénomène trans émerge en grande partie du travestissement masculin. Tous les principaux « concernés » le reconnaissent et le revendiquent même ouvertement, ainsi que nous le montrons dans notre livre Né(e)s dans la mauvaise société – Notes pour une critique féministe et socialiste du phénomène trans, paru en 2023. L’essentiel de ce que je rapporte ci-après en provient.
Nous citons notamment les propos de l’« historien trans » Susan Stryker (un homme qui se dit femme, « femme trans »), et plus précisément son livre Transgender History (« Histoire transgenre »). Stryker remarque par exemple que « le plus ancien rassemblement transgenre toujours actif » des États-Unis est la Fantasia Fair (foire Fantasia). Or, la Fantasia Fair était à l’origine une semaine de rencontres pour travestis (pour hommes qui se travestissaient en femmes), dont la première édition s’est tenue à Provincetown, dans le Massachusetts, en 1975. Il s’agit à peu près de la même chose aujourd’hui, même si l’évènement, qui s’appelle maintenant « TransWeek », soit « Semaine trans », ne se limite plus à des individus travestis mais comprend aussi des personnes opérées (« transsexuels » ou « transgenres »), et cherche désormais à attirer de soi-disant « hommes trans ».
En France, une des plus anciennes sinon la plus ancienne association pour « personnes trans » encore existante est l’Association Beaumont Continental (ABC). Cette association, dont le but consiste aujourd’hui à créer du « lien social entre les personnes transidentitaires », a été créée en 1975 par deux hommes afin de proposer aux hommes qui se travestissent d’échanger et de se rencontrer. Là encore, on observe donc une continuité très claire. Les deux fondateurs de l’ABC étaient d’ailleurs membres de la branche européenne de l’association de travestis Foundation for Full Personality Expression (FPE) créée par Virginia Prince aux États-Unis. Virginia Prince, né Arnold Lowman dans une famille riche de Los Angeles en 1912, est à l’origine des « premières organisations pérennes consacrées aux questions transgenres », comme l’explique Stryker. C’est pourquoi il « doit être considéré comme une figure centrale de l’histoire des débuts du mouvement politique transgenre contemporain ». En 1952, Prince fonde le premier magazine états-unien dédié aux travestis, appelé Transvestia. À partir de 1960, il commence à organiser régulièrement des rassemblements d’hommes qui se travestissent. Le célèbre militant trans états-unien Riki Wilchins reconnaît lui-même :
« […] ce premier petit rassemblement de personnes transgenres — finalement baptisé le club “Hose & Heels” [“Bas et talons”] — allait, à peine trois décennies plus tard, devenir le mouvement moderne de défense des droits des transgenres. Tout débuta avec des hommes hétérosexuels [en vérité, certains étaient homosexuels mais préféraient le taire à l’époque] qui se travestissaient. »
Le travestissement désigne le fait d’« adopter des habitudes vestimentaires et sociales du sexe opposé » (Larousse). Et j’ajouterais, pour préciser l’objet de la discussion, le fait de se dire de – ou de passer pour – l’autre sexe. (Le transsexualisme ou le transgenrisme, en ajoutant à cela des opérations chirurgicales et des injections hormonales visant à obtenir une plastique proche de celle de l’autre sexe, n’ont en quelque sorte fait qu’augmenter l’intensité du travestissement.)
Je ne pense pas que le travestissement soit en lui-même une mauvaise chose. Il peut être tout à fait défendable. Par exemple, dans la mesure où il peut désigner le fait, pour des femmes, de s’émanciper de normes sociales oppressives en s’autorisant à adopter des vêtements, des comportements ou des activités considérées comme masculines dans notre culture. Cependant, à l’inverse, le travestissement masculin peut avoir pour effet de perpétuer des attributs et des stéréotypes sexistes (ceux que la société patriarcale assigne au sexe féminin), et donc de renforcer les normes sociales oppressives auxquelles le « travestissement » féminin permet justement d’échapper. Il ne semble donc pas judicieux de parler de « travestissement » dans un cas comme dans l’autre, étant donné que cela tend à masquer les différences majeures qui existent entre les « travestissements » féminins et masculins : les femmes ne se sont historiquement pas travesties pour les mêmes raisons que les hommes. En général, elles l’ont même fait pour des raisons diamétralement opposées.
Quoi qu’il en soit, qu’un homme enfile des « vêtements de femmes » ne pose pas intrinsèquement de problème (surtout que ces « vêtements de femmes » sont en fait souvent des vêtements conçus par des hommes mais imposés aux femmes par la culture patriarcale, comme les talons-aiguilles, les jeans trop serrés, les bikinis, etc.). Le travestissement masculin présente néanmoins des aspects sexistes, conservateurs et même réactionnaires. Pour le saisir, il est utile de connaître la critique féministe de l’« érotisation de la domination » qu’ont formulée Kate Millett, Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon ou encore Sheila Jeffreys.
L’érotisation de la domination est l’un des rouages les plus insidieux du patriarcat, un mécanisme si profondément ancré qu’il semble, aux yeux de beaucoup, relever de la nature même des choses, y compris du désir. Depuis des décennies, la culture, les institutions et les récits dominants façonnent une sexualité asymétrique où la domination et la soumission constituent des structures fondamentales du rapport entre les sexes. La littérature masculine met en scène une logique où la conquête amoureuse est toujours une guerre, la femme, un territoire à soumettre, le sexe, un champ de bataille où la jouissance se confond avec la domination. L’homme s’impose comme sujet désirant, actif, conquérant. La femme, elle, est objet de désir, passive, réceptacle des fantasmes qu’on lui assigne. Cette assignation infériorisante conditionne depuis longtemps l’expérience du plaisir, en modelant l’imaginaire collectif de sorte que la soumission féminine n’apparaisse pas comme une aliénation, mais comme une composante naturelle du jeu érotique. Ainsi que Sheila Jeffreys le souligne dans ses travaux, les sexologues ont historiquement encouragé les femmes à trouver du plaisir dans la soumission, à désirer leur propre subordination, à voir dans l’abandon aux exigences masculines une preuve d’amour, une promesse de plénitude. Ce faisant, les sexologues ont façonné une sexualité féminine conforme aux attentes des hommes.
Comme en témoignent les productions culturelles contemporaines, la publicité, le cinéma, la mode, cette dynamique est encore omniprésente. Partout, le corps féminin est offert, livré au regard et à l’appropriation ; partout, la puissance virile est glorifiée. Dans la pornographie contemporaine, l’inégalité est non seulement mise en scène, mais exaltée : la douleur féminine est travestie en plaisir, la brutalité masculine en expression légitime du désir. Le sexe est réduit à une mise en scène du pouvoir, où l’homme exerce et la femme subit. La sexualité hétérosexuelle se construit aujourd’hui normativement sur une fiction où le plaisir des femmes est indissociable de leur soumission. Ainsi, l’érotisation de la domination structure nos relations, nos attentes, nos manières d’aimer et de désirer. Elle ne se contente pas de justifier l’inégalité, elle l’inocule dans l’intime, elle en fait une source de plaisir, elle transforme l’oppression – le différence de pouvoir – en source d’excitation. La prostitution relève elle aussi de ce schéma, où l’excitation sexuelle masculine repose sur la dégradation, la soumission et l’exploitation des femmes.
C’est ici que l’on rejoint le travestissement (masculin). Nombre de travestis (et dans la suite de ce texte, lorsque je parle de travestis, je fais uniquement référence à des hommes, des mâles humains adultes), de leur propre aveu, se travestissent afin d’assouvir une sorte de pulsion sexuelle. Une étude publiée en 1997 dans la revue Archives of Sexual Behavior, menée par Virginia Prince et le psychologue Richard F. Docter auprès de plus d’un millier de travestis, rapporte que presque tous « déclarent éprouver des sentiments agréables et souvent une gratification sexuelle en se travestissant ». Le fait de s’imaginer « en femme », assignés au rôle social et sexuel des femmes, c’est-à-dire de s’imaginer dans une position sociale et sexuelle de subordination, les excite et leur procure une importante jouissance sexuelle. Les « vêtements de femmes », conçus pour être contraignants, voire douloureux (corsets, talons hauts, etc.), ne sont qu’un moyen de réaliser leur fantasme. C’est pourquoi ils ne sont pas la question. Le problème, c’est que ces hommes retirent leur plaisir sexuel de l’érotisation de la domination qui constitue une composante centrale du système patriarcal.
Pour le constater, il suffit d’ouvrir n’importe laquelle des nombreuses revues écrites par et pour des travestis, comme le magazine Transvestia, créé par Virginia Prince (né Arnold Lowman), une figure historique majeure du travestissement et du mouvement trans, et publié entre 1960 et 1986, ou comme la revue Cross-Talk: The Transgender Community's News & Information Monthly, publiée entre 1990 et 1996 (ou encore comme LadyLike, Female Mimics, Female Mimics International, The TV/TS Tapestry, Female Impersonators, etc.). Dans toutes ces publications, on trouve des pages et des pages, écrites par des hommes, d’histoires de fantasmes sexuels ouvertement liées à l’« érotisation de la domination » (je fais ici référence à des publications parues entre les années 1960 et 2000, par la suite, il est possible qu’ils aient compris qu’il valait mieux ne pas exprimer trop ouvertement leurs fantasmes, étant donné leur teneur). Au hasard, dans le numéro 25 de Transvestia, en date de février 1964, une histoire présente une sorte de jeu agressif entre un homme efféminé (auquel le travesti est censé s’identifier) et une femme qui, en l’agressant physiquement, exige de lui qu’il dise : « Je suis une jeune femme soumise et féminine. » Durant le combat, la femme se moque de l’homme en lui disant qu’il lutte « comme une fille », puis le traite « de “fillette” (sissy), “tapette” (pansy), “femmelette” (pantywaist), “petite fille” ».
Ce type d’histoire – sachant celle-ci est très soft au regard de ce qu’on trouve dans les magazines – appartient au registre du fantasme dit de « féminisation forcée », très courant dans la littérature pour travestis, et qu’on retrouve aussi dans certaines pratiques du BDSM. Il s’agit d’un scénario dans lequel un homme est contraint, par une force extérieure (souvent une femme dominante), à adopter une apparence ou un comportement « féminin » (selon les stéréotypes que la société patriarcale associe au « féminin »). Cette contrainte peut être physique, psychologique ou sociale, et elle est souvent accompagnée d’une humiliation ou d’une mise en scène de la perte de pouvoir. La féminisation forcée repose sur l’idée que le statut féminin est inférieur ou humiliant (ce qu’il est, dans les sociétés patriarcales). Elle s’inscrit dans le phénomène plus vaste de l’érotisation de la domination.
Or – et cela devrait être évident – il n’y a rien de subversif dans le fantasme de la « féminisation forcée », rien qui ébranle l’édifice patriarcal. Au contraire, il en représente une caricature obscène. L’homme qui s’adonne à ce jeu jouit de ce qui, pour les femmes, ne relève pas du plaisir, mais de l’oppression. La violence qu’elles subissent au quotidien — être réduite à son apparence, se voir dicter sa tenue, être soumise au regard qui évalue, qui contrôle, qui contraint — devient pour lui une source d’excitation. Il ne subit pas la féminité comme une condition à laquelle il ne peut échapper, mais l’utilise comme une punition délicieuse, une transgression jouissive à laquelle il s’adonne librement. Il se grise de cette posture de soumission, mais il n’a jamais eu à la vivre dans sa brutalité, dans son inexorabilité. Il n’a pas eu son corps malmené par l’industrie médicale lors de la grossesse, il n’a pas à s’occuper des enfants, à effectuer des heures de tâches ménagères en plus chaque jour, à gagner moins d’argent, à vivre dans la peur d’une agression sexuelle, à être traité par les institutions, les commerçants, les patrons, la société entière avec condescendance et paternalisme. Pour lui, les talons, les bas, la jupe et le rouge à lèvres sont des fétiches ; pour elles, ils sont des injonctions. En cela, le travestissement masculin constitue, au moins en partie, une pratique indécente et même insultante vis-à-vis des femmes.
À la fin des années 1980, l’autrice britannique Annie Woodhouse entreprit d’étudier les effets du travestisme des hommes sur leurs épouses ou compagnes – ce qui n’avait encore jamais été fait. Au bout du compte, elle publia un livre intitulé Fantastic Women: Sex, Gender and Transvestism en 1989. Initialement, elle avait envisagé ce projet comme « une enquête sur les règles tacites de la démarcation entre les sexes, visant à démontrer que le travestissement est un moyen de faire tomber les barrières ». Ses illusions s’envolèrent rapidement. En allant à la rencontre de groupes de travestis masculins, elle parvint à prendre contact avec certaines épouses ou compagnes, et décida de s’entretenir longuement avec cinq d’entre elles. Rapidement, Woodhouse réalisa que le travestisme n’a rien de subversif, puisqu’il « reproduit les divisions liées au genre » et « s’appuie sur des images des femmes qui ont été utilisées pour les objectifier et les opprimer ». Le travestissement constitue « un processus à sens unique, par lequel les hommes adoptent l’imagerie féminine pour leur satisfaction sexuelle, leur relaxation et leur plaisir ».
Sur les cinq épouses de travestis dont Woodhouse rapporte l’histoire, deux se retrouvent — temporairement — en hôpital psychiatrique en raison de problèmes psychiques liés à ce que leurs maris leur font subir. Jeff, le mari de Susan, une autre épouse, se montre violent envers elle lorsqu’elle échoue à le soutenir pleinement dans tous ses fantasmes. Les femmes mariées à des travestis n’ont souvent pas les moyens de quitter leur mari, dépendance économique oblige. Lorsque le couple a des enfants, les femmes ont encore plus de mal à partir. La vision d’ensemble de la vie des épouses de travestis qui ressort des entretiens menés par Woodhouse est assez calamiteuse. Comme elle le note ensuite :
« Il est peut-être significatif que, lors d’un grand rassemblement de travestis aux États-Unis, Beigel (1969) ait constaté que le nombre d’hommes divorcés était presque le double de la moyenne nationale, et que presque tous admettaient que la raison du divorce était l’opposition de leur femme à leur travestissement. Leurs épouses s’opposaient à leur masturbation secrète et à leurs exigences sexuelles, ainsi qu’à la pression imposée au budget familial par l’entretien d’une garde-robe supplémentaire. Ce dernier aspect est mis en évidence par Beigel qui rapporte la réaction de colère et d’horreur d’une femme qui avait accompagné son mari au rassemblement et qui était affligée de voir ses nouveaux vêtements coûteux achetés avec ses revenus à elle, à son insu. La réponse du mari fut simplement que le travestissement constituait pour lui une forme de thérapie et de relaxation, et qu’elle devait donc s’en accommoder. »
Certaines figures contemporaines du mouvement trans affirment ouvertement – fièrement – que leur « transidentité » est un produit du fantasme de la « féminisation forcée ». Andrea Long Chu, par exemple, né Andrew, un auteur et critique littéraire états-unien, qui se dit aujourd’hui « femme trans », qui a écrit pour le New York Times, le New York Magazine et a reçu un prix Pulitzer en 2023, écrit, dans son livre Females (paru en français sous le titre Femelles) : « le porno sissy m’a rendu trans. »
Qu’est-ce que le « porno sissy » ? Il s’agit d’une sous-catégorie de « porno transgenre » qui a récemment émergé et beaucoup gagné en popularité. On parle aussi de « sissy hypno » — abréviation de « sissification hypnosis » (« hypnose sissifiante »). Ce type de pornographie, destiné aux hommes, se retrouve en ligne sous trois formes principales : vidéos pornographiques, fichiers audio et images avec texte. Le terme « sissy », qui était à la base un diminutif du mot anglais « sister », signifiant « sœur », est aujourd’hui un terme péjoratif, misogyne et homophobe, qui désigne un garçon ou un homme efféminé, un peu comme « fillette ». L’expression anglaise « sissy porn » pourrait être traduite par « porno de fillette », et l’expression « sissification pornography » par « pornographie de fillettisation ».
Comme l’explique la journaliste Genevieve Gluck : « cette pornographie met généralement en scène des hommes portant de la lingerie et se livrant à une “féminisation forcée” : il s’agit d’une érotisation de l’idée de “devenir une femme” par l’habillement, le maquillage et la soumission sexuelle, et d’une fétichisation de l’humiliation qui en résulte. »
Encore une fois : rien de tout ça n’est subversif, émancipateur ou progressiste. Il ne s’agit que de fantasmes misogynes, produits d’une culture misogyne et patriarcale. Il est aussi dramatique que consternant que des gens promouvant ouvertement de tels fantasmes soient célébrés. L’érotisation de la domination n’a rien de subversive, émancipatrice ou progressiste. Au contraire, elle est constitutive du patriarcat. Elle légitime et perpétue les inégalités entre les sexes. Elle empêche une véritable égalité sexuelle – car tant que le plaisir est associé à la domination, les rapports de pouvoir perdurent. Elle banalise les violences sexuelles – notamment contre les femmes. Elle alimente la culture du viol, en suggérant que la coercition et la soumission sont des sources de plaisir. Elle aliène la sexualité des femmes. Et elle alimente l’industrie de l’exploitation sexuelle des femmes (pornographie, prostitution, etc.), qui repose sur la stimulation de l’appétit masculin pour la soumission et l’humiliation des femmes.
Cela dit, il me faut préciser plusieurs choses. Je ne dis pas ici que toutes les formes de travestissement masculin ont toujours relevé de l’érotisation de la domination. Dans des sociétés autochtones, dites « traditionnelles », il a existé des formes de travestissement masculin (les prétendus « troisième genre ») ne relevant pas de l’érotisation de la domination. Il s’agissait d’hommes jugés efféminés, échouant à incarner les exigences viriles de la masculinité et/ou attirés par les attributs de la féminité, que leur culture – également patriarcale – rangeait alors dans une catégorie sociale spécifique, inférieure à celle des hommes, mais parfois supérieure à celle des femmes. Autrement dit, même lorsque le travestissement masculin ne relevait pas de l’érotisation de la domination, il relevait tout de même de l’attribution rigide de rôles sociaux et sexuels dans le patriarcat et d’une hiérarchisation des sexes (il n’avait rien de subversif, au contraire, il était là encore une composante du patriarcat). Je ne dis pas non plus ici que toutes les personnes transgenres de sexe masculin qui se disent transgenres le font parce qu’elles érotisent la domination ou parce qu’elles ont un fantasme de féminisation forcée. Aujourd’hui, les motifs qui poussent des jeunes ou des adultes à se dire « trans » sont divers. Les filles et les femmes, en général, ne le font pas pour les mêmes raisons que les garçons et les hommes. Chez les filles et les femmes, ces raisons sont souvent d’ordre traumatique (la « transidentité » servant alors de moyen de fuir une condition trop pénible).
Pour clarifier, je soutiens ici :
que l’érotisation de la domination et les fantasmes de « féminisation forcée » constituent historiquement un des motifs principaux du travestissement masculin ;
que les militants les plus déterminés du mouvement trans ont historiquement été des hommes présentant un très fort fétichisme de travestissement, lié à l’érotisation de la domination ;
que le travestissement masculin lié à l’érotisation de la domination et les pulsions qui le sous-tendent constituent donc une des principales origines du phénomène trans contemporain.
J’imagine déjà les réactions d’outrage et de panique morale de nombre de braves gens de gauche, n’ayant jamais passé plus d’une demi-heure de leur vie à s’intéresser sérieusement à l’histoire du mouvement trans ou du travestissement, mais adhérant néanmoins aveuglément et frénétiquement à la ligne du Parti (selon laquelle le phénomène trans et le travestissement, tout ça, c’est super). « Mais c’est n’importe quoi ! » « Mais non, mais, non ! » « Les travestis et le travestissement, ce n’est pas ça ! » « Le mouvement trans non plus ! » « Transphobie ! » etc.
Et pourtant si. Ouvrez les yeux. Et puis des livres. Au lieu de répéter ou de croire bêtement ce que les autres répètent aussi, consultez vous-mêmes les revues pour travestis. Des centaines, voire des milliers d’exemplaires (anglophones) numérisés sont en accès libre sur www.digitaltransgenderarchive.net. Lisez sur l’histoire du mouvement trans, ses principaux protagonistes, ses principaux lobbyistes. Et réfléchissez. Le mouvement que vous célébrez religieusement n’est qu’une des nombreuses manifestations de la domination masculine. En le soutenant, la gauche contredit tous les principes de lutte pour la justice, pour l’égalité et contre les dominations qu’elle est censée incarner.




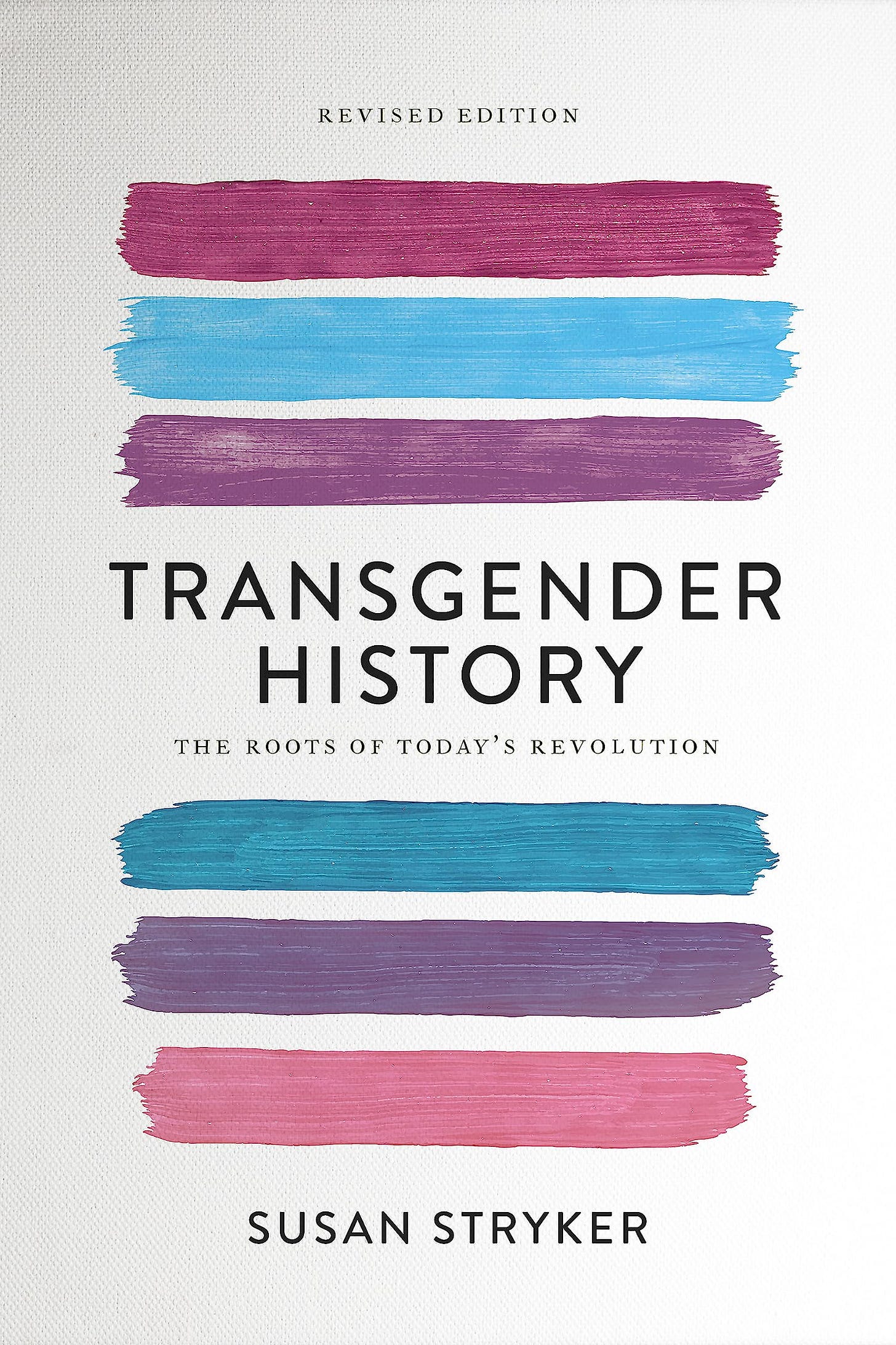



À l'instar de beaucoup d'autres choses, le mouvement trans favorise les hommes.. OK. Alors, pourquoi l'émancipation des femmes passerait-elle par le fait de se travestir en hommes? Parce que ce sont les dominants, parce qu'ils sont "pratiques"? Pour des corps de femmes non androgynes et non obsédés par la minceur absolue, les vêtements masculins (même "féminisés" tels les jeans) ne sont ni très confortables (contrairement à un sarouel par exemple) ni esthétiques et je ne vois pas pourquoi nous renoncerions à l'esthétique et à la fierté de nos corps de femmes.
Je ne parle pas ici de l'esthétique dégagée par les travestissements des hommes que je trouve caricaturaux pour ne pas dire grotesques ...
Annie Gouilleux